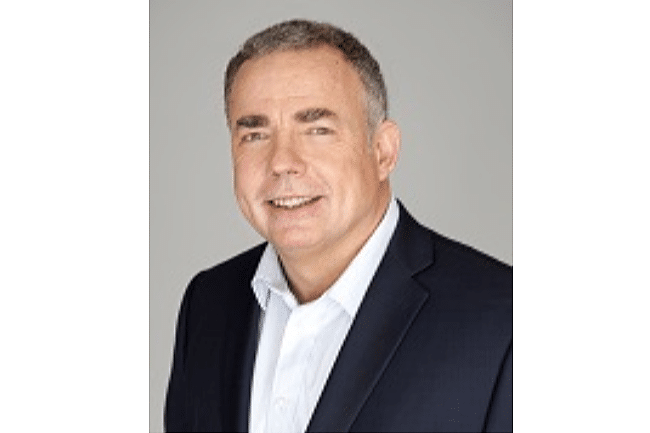Alors que les villes se densifient et que les attentes des citoyens en matière de sécurité, de mobilité et de qualité de vie augmentent, les technologies connectées offrent de nouvelles perspectives pour repenser l’organisation urbaine. En unifiant les données et en facilitant la coordination entre services, elles permettent une gestion plus efficace, plus préventive et plus réactive de l’espace public.
D’ici 2050, 70 % de la population mondiale vivra dans les villes, un chiffre révélé lors de la deuxième session de l’Assemblée du Programme des Nations Unies pour les Établissements Humains « UN Habitat » qui s’est tenue en juin 2024. L’augmentation de la population urbaine représente un défi en termes de sécurité et de protection des personnes et des biens. C’est notamment pour répondre à ce besoin de sécurité, que les villes se tournent vers la technologie. Une smart city est un lieu où les citoyens peuvent vivre, travailler, se déplacer librement et bénéficier d’une meilleure qualité de vie avec des niveaux élevés de mobilité, de sécurité et d’efficacité, y compris dans les systèmes de transport public et énergétiques. Les villes adoptent progressivement des technologies intelligentes pour renforcer la sécurité, en optimisant les réseaux de surveillance, en exploitant les données et en améliorant l’efficacité et la durabilité. L’objectif : mieux comprendre et anticiper les événements pour une gestion plus réactive de l’espace urbain. En France, le concept de smart city prend de l’ampleur, avec une intégration croissante des données dans divers domaines : administration interne (59 %), gestion environnementale (58 %), mobilité (55 %), gestion des déchets (40 %) et sécurité (12 %)[1].
C’est le cas de Nantes Métropole, qui regroupe 24 communes et plus de 600 000 habitants, et a progressivement renforcé son dispositif de surveillance et de gestion du trafic pour améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements. Dès 2001, elle installe ses premières caméras afin de contrôler l’accès aux zones piétonnes et d’abaisser les bornes escamotables uniquement pour les véhicules autorisés. En 2006, la métropole franchit une nouvelle étape avec la création d’un PC Circulation permettant de surveiller en temps réel l’état du trafic et de le réguler efficacement. Trois ans plus tard, cette couverture s’étend aux transports en commun et au périphérique nantais. Depuis 2017, Nantes Métropole a consolidé l’ensemble de ses dispositifs en adoptant une plateforme de sécurité unifiée, qui centralise la gestion vidéo au sein du Centre de Supervision Urbain (CSU). Ce dernier joue un rôle clé dans l’optimisation des interventions des forces de l’ordre et des secours, leur offrant une visibilité instantanée sur les incidents. Doté d’un mur d’images de 12 écrans et de postes équipés pour ses opérateurs présents 24h/24, le CSU permet une surveillance en continu et une réactivité accrue face aux délits ou aux accidents.
Connectée mais pas forcément sécurisée
Mais une ville connectée n’est pas nécessairement une ville sûre : les données ne doivent pas seulement être collectées et analysées, mais doivent être agrégées pour devenir un outil de soutien à la décision. Les informations provenant de diverses sources (caméras vidéo, systèmes de contrôle d’accès, lecteurs de plaques d’immatriculation, etc.) peuvent être unifiées dans un système unique permettant une vue d’ensemble de la sécurité physique pour réduire les risques, améliorer la collaboration et automatiser les procédures. Ces mêmes solutions peuvent être adoptées dans le secteur des services de transport public, comme les métros ou les bus, et peuvent être configurées pour avertir, par exemple, les cyclistes en temps réel du meilleur itinéraire à choisir en fonction des conditions de circulation et météorologiques.
Pouvoir compter sur des canaux de communication ouverts entre les institutions et les réalités qui opèrent en leur sein est fondamental non seulement pour coordonner, par exemple, les efforts avec les forces de l’ordre afin qu’elles interviennent de la manière la plus rapide, mais aussi pour apporter des modifications prédictives à l’allocation et à l’utilisation des ressources en identifiant les éventuels points faibles et en renforçant les défenses.
[1] Les collectivités territoriales et la donnée, Baromètre de l’Observatoire Data Publica 2024